Chaque année, le prix de la sardine s’envole dès le début du ramadan, transformant ce poisson du peuple en un produit hors de portée pour de nombreux ménages. Entre spéculation, pénurie organisée et récupération politique, cette hausse brutale révèle des tensions bien plus profondes que de simples fluctuations de marché.
Casablanca, marché central. Devant un étal où les sardines s’entassent sur de la glace fondante, Ahmed, 52 ans, inspecte les prix d’un air contrarié. « À 25 dirhams le kilo, comment voulez-vous qu’on s’en sorte ? » lâche ce père de trois enfants, dont le budget alimentaire a déjà été laminé par l’inflation. Chaque année, la même scène se répète : dès les premiers jours du ramadan, ce poisson, autrefois bon marché et accessible à tous, devient l’objet de toutes les crispations.
Les consommateurs dénoncent un prix qui a doublé en quelques jours. Comme Ahmed, des milliers de Marocains font le même constat : un poisson qui se négociait entre 10 et 12 dirhams atteint désormais 20 à 25 dirhams. Dans certaines villes comme Marrakech ou Fès, le prix frôle même les 30 dirhams.
Pour beaucoup, la sardine n’est plus l’aliment du peuple, mais un luxe inabordable. « Avant, c’était notre solution quand la viande était trop chère. Maintenant, même elle devient inaccessible », se désole Khadija, une mère de famille croisée au marché.
En théorie, le prix de gros de la sardine ne dépasse pas 3 dirhams le kilo au port. Alors comment expliquer que le consommateur doive payer jusqu’à 10 fois plus cher ? La question enflamme les débats et met en lumière le rôle trouble des intermédiaires.« Il y a une dérégulation totale du marché. Certains acteurs créent artificiellement la rareté pour gonfler les prix », accuse un ancien mareyeur sous couvert d’anonymat.
« Il est inconcevable , par exemple, que le prix de gros de la sardine, ne dépassant pas 3 dirhams le kg, soit ensuite proposé au consommateur à un prix oscillant entre 15 et 20 dirhams le kg », s’indigne un député marocain cité par le site d’information Le360.
Or qui est responsable de cette flambée ? Intermédiaires trop gourmands, désorganisation du marché ou manipulation des stocks ? Si les autorités annoncent régulièrement des contrôles renforcés, les citoyens restent sceptiques. Un poissonnier fait trembler le marché.
Cette année, cette polémique a franchi un nouveau cap avec l’émergence d’un acteur inattendu qui est venu troubler le jeu : Abdelilah Moul Sardine, un poissonnier de Marrakech, devenu une sensation sur TikTok. Dans ses vidéos virales, il vend la sardine à 5 dirhams le kilo et accuse les spéculateurs de gonfler artificiellement les prix. Son initiative, relayée massivement sur les réseaux sociaux, a mis le gouvernement d’Aziz Akhannouch sous pression. Selon le journal marocain Le Matin, son initiative a mis en évidence « mis à mal l’argumentaire du gouvernement et montré à quel point la spéculation est la principale cause de la cherté du poisson».
Depuis les campagnes en ligne qui se multiplient, la toile marocaine s’est enflammée, dans un contexte marqué par les prémices d’une campagne électorale informelle, à quinze mois des législatives de 2026.
En réponse, les autorités ont multiplié les descentes dans les marchés de gros, mais l’effet reste limité. « Il y a un problème structurel dans la distribution des produits de la mer », analyse un expert du secteur. « Entre la demande explosive pendant le ramadan, les quotas de pêche et la spéculation, la sardine devient un enjeu économique autant que politique. »
Mais la flambée des prix ne s’explique pas uniquement par la spéculation. Le repos biologique de janvier et février, période durant laquelle la pêche est suspendue pour préserver les stocks, réduit l’offre au moment où la demande explose. Ce déséquilibre conjoncturel accentue encore les tensions.
Pourtant, à quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans les eaux du Sahara occidental, la sardine ne manque pas. Dakhla, devenue l’un des principaux hubs de la pêche industrielle en Afrique du Nord, voit ses usines tourner à plein régime. Étant le poumon d’un secteur créant plus de 14 000 emplois directs. ce qui équivaut à 30% de la population active régionale et qui a une implication significative des femmes (60%). De plus, avec la production annuelle générant plus de 3 milliards de dirhams, la région est entre autres un moteur économique essentiel pour le Maroc.
À l’abri des regards, les acteurs de la filière ont peu à peu conçu une architecture professionnelle capable de pérenniser leurs acquis. C’est dans cet esprit qu’est née une structure fédératrice à Dakhla, regroupant des armateurs industriels de la pêche pélagique : la Confédération Marocaine des Armateurs Industriels de la Pêche Pélagique (COMAIP). Dans un sens, la sardine constitue un socle majeur pour l’economie halieutique marocaine, comme le rappelle le président de la COMAIP, Mohammed Lamine Hormatallah : « la sardine est plus qu’un produit bon marché’ plus qu’une simple protéine prisée à l’heure du ftour. Elle est devenue un symbole de la transformation industrielle d’une région clé, un levier de souveraineté et un vecteur d’espoir pour une jeunesse en quête de débouchés et de perspectives » explique t-il au journal Le Point.
Grâce aux nouvelles technologies, notamment les navires RSW (Refrigerated Sea Water), la filière sardinière s’est modernisée et se positionne sur les marchés internationaux.
Mais cet essor industriel ne profite pas aux consommateurs marocains, qui continuent de voir les prix s’envoler dans les marchés locaux. « L’essentiel de la production part à l’exportation, notamment vers l’Europe et l’Afrique subsaharienne. Le marché intérieur n’est pas la priorité des industriels », reconnaît un autre acteur du secteur sous couvert d’anonymat.
Si la sardine est une manne économique, elle est aussi au cœur d’enjeux géopolitiques et environnementaux majeurs. « L’arrêt tendu le 4 octobre 2024 impose des restrictions inacceptables pour le royaume du Maroc sur l’étiquetage des produits issus des provinces du Sud » relève l’analyse de l’IMIS dirigée par Kabiné Komara, ancien Premier ministre de la Guinée.
Cette décision récente de la Cour de justice européenne de restreindre l’accès des produits du Sahara au marché européen menace une partie des exportations marocaines. En effet, cela risque de priver le Maroc de ses avantages compétitifs sur le marché européen.
Face à ces défis, la filière sardinière tente d’anticiper. La COMAIP mise sur des pratiques de pêche durable et une meilleure traçabilité pour contrer la surpêche. « Une lutte active contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Grâce à une charte d’éthique solide, signée par l’ensemble de nos membres, et à un système rigoureux de traçabilité intégrale des captures, de la mer jusqu’à l’usine », commente le patron des industriels de la COMAIP.
Mais pour les consommateurs marocains, ces enjeux restent abstraits. Ce qui les préoccupe, c’est de pouvoir acheter leur poisson à un prix décent. Derrière la polémique annuelle sur la sardine, c’est une fracture sociale qui se dessine, entre un secteur halieutique tourné vers l’international et des citoyens confrontés à une crise du pouvoir d’achat toujours plus aiguë.
Infine, de la pêche artisanale aux flottes hauturières ultra-équipées, en passant par les usines de transformation, un écosystème redoutablement structuré avec des armateurs, industriels et des cadres techniques basés au Sahara occidental, tout ceci fait de la sardine marocaine un atout stratégique et un moteur de croissance durable.
Malgré cela, en attendant, sur les marchés, les ménages continuent de scruter les prix avec anxiété, en espérant que, l’an prochain, la sardine redevienne enfin un aliment du quotidien.
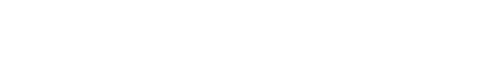

Laisser un commentaire