C’était en août 2017. Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, provoquait une onde de choc et venait rappeler combien le harcèlement sexuel est un fléau au Maroc. On y voit, à l’arrière d’un bus qui roule dans Casablanca, une jeune femme se faire agresser en pleine journée par quatre adolescents sans que personne ne bouge, ni les passagers ni le chauffeur. Le bus file tandis que la victime subit les assauts de ses agresseurs, qui la touchent, la palpent, lui dénudent le haut du corps en la moquant et en l’insultant. Une séquence inacceptable qui a relancé le débat sur le harcèlement sexuel et les conséquences graves subies par les victimes.
La scène est choquante. Pourtant, elle est loin d’être inédite au Maroc, où près de deux femmes sur trois sont victimes de violences. En effet, en termes de violences à caractère sexuel ou sexiste, le Maroc présente un bilan pour le moins déplorable. Selon des chiffres officiels, près de deux Marocaines sur trois sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste.
Au Maroc, pays qui se veut, selon les discours officiels, chantre d’un islam tolérant et où les femmes n’ont pas l’obligation de porter le voile, marcher seule dans la rue relève parfois du parcours du combattant. Elles y subissent fréquemment remarques désobligeantes et insultes.
“Psst psst”, “zine manchoufouch”, “lghzala”, “wakfi nsawlek”…
Ces phrases, des générations de femmes les ont entendues. Et des générations d’hommes les ont fièrement scandées dans les rues marocaines. Si le phénomène peut paraître normal à certains hommes de ce pays, il fait toujours autant souffrir la gente féminine. Marcher, se promener, faire ses courses, s’asseoir sur un banc public ou tout bonnement se déplacer vers son lieu de travail ou d’études devient un exercice parfois insurmontable pour la femme marocaine.
Que faut-il entendre par harcèlement de rue ? Cette expression renvoie à des attitudes et propos intrusifs, insistants et non sollicités, exprimés dans l’espace public par des inconnus, majoritairement des hommes. Cela inclut divers types de comportements : suivre, insulter, siffler, fixer du regard, commenter l’apparence physique, solliciter sexuellement, menacer, etc. Certains lieux publics apparaissent plus propices au harcèlement de rue. Les incidents rapportés par les personnes répondant à l’enquête sont principalement survenus dans la rue, dans un terrain de stationnement ou un parc. D’autres se sont produits dans un commerce, un bar, un café, un restaurant ou un centre commercial, ou encore dans les véhicules du transport en commun.
Dans le tumulte de la ville de Casablanca, entre les klaxons impatients et les bavardages incessants, une autre mélodie se joue, souvent inaudible, souvent ignorée, celle du harcèlement sexuel, une composition cacophonique de sifflements, de commentaires grossiers et de regards invisibles d’hommes anonymes.
Pour les femmes, loin d’être une source de plaisir, c’est une bande sonore constante de peur existentielle, un rappel permanent de leur vulnérabilité dans l’espace public. Chaque note, chaque mot, chaque geste non désiré laisse une empreinte sur leur psyché, un souvenir indélébile qui s’ajoute à la collection grandissante d’agressions verbales et physiques.
Au Maroc, et ailleurs dans le monde, le harcèlement sexuel de rue reste toléré. Un fléau qui a de nombreuses conséquences sur le quotidien des femmes, y compris sur leur vie sociale et professionnelle.
Les femmes, elles, se souviennent de ces sifflements aigus qui transperçaient leurs oreilles, de ces commentaires désobligeants sur leurs corps, de ces regards insistants qui les faisaient se sentir nues et exposées. Elles se souviennent de la peur qui leur serrait la gorge quand un homme les suivait de trop près, de la colère qui les envahissait quand un autre les frôlait intentionnellement. Ces incidents, loin d’être isolés, font partie du quotidien de nombreuses femmes. Ils sont les fils invisibles qui tissent la toile de la misogynie, nous rappelant constamment que nous ne sommes pas chez nous dans l’espace public.
À travers cette enquête ornée de témoignages poignants, de statistiques alarmantes et d’analyses éclairantes, qui dessinent un tableau saisissant de ce fléau qui gangrène l’espace public et réduit les femmes à de simples objets de convoitise.
Sifflements, insultes, gestes déplacés, attitudes oppressantes…
Le harcèlement sexuel de rue que subissent les femmes reste hélas très répandu. La plupart d’entre elles changent de trottoir lorsqu’elles aperçoivent un individu au loin, tandis qu’une femme sur deux confie avoir déjà été agressée verbalement dans la rue. Ce fléau est aussi fort qu’il n’a pas de conséquences uniquement à l’instant clé où les victimes le subissent, mais également sur leur choix de vie.
Pour tenter d’échapper à ce type de situation, les précautions les plus courantes consistent à éviter des lieux et des heures spécifiques, à prendre d’autres moyens de transport, à adapter leur style vestimentaire, à parler à quelqu’un au téléphone ou à marcher plus vite.
Certaines portent des objets en guise d’armes, tels que des sprays au poivre, des lames ou encore des poings américains sous forme de porte-clés ou en produit de beauté. N’oublions pas le trousseau de clés, un objet que tout individu a en sa possession, est notamment gardé en main en guise de protection.
Les chiffres stupéfiants soulignent le besoin urgent d’interventions ciblées et d’efforts concentrés pour créer une sphère publique plus sûre. Ces femmes-là attendent davantage d’actions de la part des organismes officiels. Plus de la moitié des victimes ne portent pas plainte après les faits. Ce qui revient le plus souvent est qu’elles pensent que les autorités compétentes devraient accorder plus d’attention à ce problème et proposer des solutions.
Souvent minimisé et banalisé, tant par les victimes que la société en général, les femmes culpabilisent et ont honte de parler, de peur d’être jugées ou de ne pas être crues.
Quant à Leila, 26 ans, experte en Télécommunications, elle confie “qu’ à 12 ans, avec ma classe d’anglais, on avait comme projet de réaliser un court métrage. Tout se passait bien au début jusqu’à ce qu’on change d’endroit. Pour y aller, on est passé par un quartier populaire. J’étais jeune, je portais un T-shirt et un short. Je n’étais pas formée à cette époque. Je n’étais qu’une enfant au final. Arrivé à mi-chemin, un homme me touche les fesses. Je ne saurais dire pourquoi je n’ai pas réagi sur place. Et en me confiant par la suite aux 2 encadrantes qui nous accompagnaient. La réponse était unanime. On ne peut rien y faire, regarde toi, ton short est un peu court quand même”.
De plus, les auteurs de ces violences bénéficient souvent d’une impunité quasi totale. Les plaintes sont rarement déposées et les sanctions, lorsqu’elles existent, sont souvent insuffisantes.
L’éclairage public reste de plus en plus fréquemment éteint, pour faire des économies et pour lutter contre la pollution lumineuse. Une bonne initiative en soi, mais qui alimente le sentiment d’insécurité des femmes.
La rue, autrefois synonyme de liberté et de découverte, devient un terrain miné où chaque pas est une source d’appréhension. De ce fait, elles sont contraintes de modifier leur comportement, d’éviter certains lieux ou certaines heures de la journée et de rester sur leurs gardes.
Le Maroc, comme de nombreux pays du monde, est marqué par une société patriarcale où les hommes occupent une position dominante. Les femmes, quant à elles, sont souvent considérées comme ”inférieures” et “soumises” aux hommes. Cette vision sexiste se traduit par des stéréotypes de genre profondément ancrés dans la société. Percues comme des objets sexuels, leur corps “appartient” aux hommes qui ont le “droit” de les commenter et de les toucher sans leur consentement.
Ghali Benklif, 35 ans, raconte cette brève scène, vue à un arrêt de tramway dans le quartier Ain Diab à Casablanca, d’un garçon à vélo, « 12 ans à tout casser », saisissant les « fesses » d’une jeune femme qui marchait : « Pour lui, ce n’était rien. Une histoire à raconter aux copains, pour se marrer. Pour elle, je ne pense pas qu’elle réussirait à supprimer cette demi-seconde de sa mémoire. »
Ces comportements harcelants sont perçus différemment, mais l’impact sur la victime est toujours présent.
Or, pour Mounir, 23 ans, étudiant en droit pénal, fait partie du groupe d’individus qui affirme clairement que « la gente féminine doit avoir une certaine pudeur. Nous en tant qu’hommes, notre instinct animal prend le dessus. » Il renchérit en disant « apprenez-vous à vous habiller correctement, on est dans un pays conservateur. Ne venez pas vous plaindre si vous vous faites harceler dans la rue ».
Ces dernières années, plusieurs cas d’agressions ont défrayé la chronique, notamment sur les plages, où les femmes hésitent de plus en plus à se mettre en maillot de bain. Ces agressions revêtent un caractère collectif et décomplexé, de la part de jeunes se considérant comme « défenseurs de la vertu ».
En 2016, une page Facebook, fermée depuis, incitait à prendre en photo des femmes en bikini pour les désigner à la vindicte publique.
Selon l’ancienne ministre, Nouzha Skalli, le poids de la culture traditionnelle pèse encore trop lourdement sur les esprits : ” L’espace public serait réservé aux hommes et la présence des femmes serait considérée comme une intrusion indue “. La société marocaine semble tiraillée entre une ouverture et un conservatisme tenace, observe Nouzha Skalli. La militante pour l’égalité des sexes déplore ” la propagation d’une idéologie mysogine et agressive qui accuse les femmes de s’habiller de façon provocante et les considère comme responsables “.
Les chiffres sont éloquents : plus d’un Marocain sur deux reconnaît avoir déjà harcelé sexuellement une femme dans l’espace public et plus de 60 % des femmes déclarent avoir déjà été victimes de ce type d’agression, selon une récente étude publiée par l’ONU Femmes Maghreb. Symptomatiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à estimer que l’apparence de la victime provoque le harcèlement, selon cette étude.
Par ailleurs, une étude menée de mai à juillet 2016 dans la région de Rabat, Salé et Kénitra, par le bureau régional d’ONU Femmes pour les États arabes, révèle que 63 % des femmes interrogées ont été confrontées à des actes de harcèlement sexuel – principalement des regards insistants, des commentaires sexuels et des traques. Plus de la moitié (53 %) des hommes reconnaissent avoir déjà harcelé sexuellement une femme ou une fille (dont 35 % au cours des trois derniers mois).
Près de 60 % de ceux qui ont indiqué avoir commis un acte de violence sexuelle à l’encontre d’une femme ou d’une fille dans les espaces publics ont affirmé qu’ils l’avaient fait pour s’amuser ou pour le plaisir. Plus de 60 % des hommes interrogés ont par ailleurs soutenu que la tenue vestimentaire d’une femme jugée “provocatrice” – par eux – ainsi que sa présence dans un lieu public pendant la nuit, ont constitué des raisons légitimes de violence sexuelle.
Dans le même temps, 42 % des femmes ont déclaré qu’une femme apprécie de telles “attentions”, contre plus de 70 % des hommes interrogés.
Il ressort également de cette étude, menée auprès de 1 200 hommes et 1 200 femmes âgés de 18 à 59 ans, que seulement un quart des hommes et un tiers des femmes connaissent les dispositions de lois sur la violence à l’égard des femmes, le divorce, le mariage précoce, le quota pour la représentation politique des femmes au parlement, etc. La majorité des personnes interrogées – 87 % des femmes et 56 % des hommes – s’accorde à affirmer que davantage de travail et d’efforts devraient être faits pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais la moitié des personnes interrogées, respectivement 50 %
des hommes et 48 % des femmes, pense que l’idée de l’égalité entre les sexes ne fait pas partie des “traditions et de la culture marocaine”.
Un fléau tenace malgré des avancées notables
Si le code pénal marocain réprime ce fléau, la loi, elle, reste floue et son application est souvent défaillante. En effet, la peur des représailles, la stigmatisation et l’inefficacité du système judiciaire alimentent l’hésitation de chaque femme à passer à l’action en effectuant un dépôt de plainte.
Les femmes marocaines sont-elles assez protégées ?
Dans un sens, si des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années, notamment sur le plan juridique, la lutte contre ce phénomène complexe et multiforme demeure un chantier en cours.
Un arsenal juridique renforcé
Rappelons qu’en 2018, le Maroc a franchi une étape importante avec l’adoption de la loi 103-13, qui incrimine explicitement le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement de rue. Cette loi punit les auteurs d’emprisonnement et d’amendes, envoyant un message fort de tolérance zéro face à ces comportements, avec des peines allant d’un mois à un an d’emprisonnement et d’amendes de 2000 Dhs à 10.000 Dhs. Les peines sont alourdies si l’auteur est un collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité des lieux publics, ou encore quelqu’un qui a une autorité ou tutelle sur la victime en question.
Entrée en vigueur mi-septembre après plusieurs années de débats, cette loi incrimine pour la première fois des actes « considérés comme des formes de harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle ou de mauvais traitement ». Bien qu’elle soit essentielle, l’interdiction législative du harcèlement sexuel n’est pas suffisante pour enrayer ce comportement. Jugé insuffisant par les groupes féministes, le texte durcit les sanctions dans certains cas et prévoit des mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences.
L’article 448-1 du Code Pénal vient compléter ce dispositif en punissant ces actes avec des peines allant de 2 à 5 ans d’emprisonnement. De plus, les articles 503-1-1, constituent notamment un complément. Ils prévoient que « toute personne qui a harcelé l’autre de manière persistante est considérée comme coupable de harcèlement dans les espaces publics ou autres, par des agissements, paroles, gestes à caractère sexuel à des fins sexuelles ».
Cette loi, bien qu’étant un premier pas important, présente des lacunes. Les sanctions prévues restent peu dissuasives et les procédures de plainte sont souvent complexes et opaques. Un renforcement du cadre législatif et une application plus effective des lois existantes sont nécessaires pour lutter efficacement contre le harcèlement sexuel.
Bien qu’elle soit essentielle, l’interdiction législative du harcèlement sexuel n’est pas suffisante pour enrayer ce comportement. D’autres mesures doivent être adoptées, qui peuvent être imposées par la loi, comme des politiques internes contre le harcèlement sexuel, des mécanismes de plainte, l’augmentation du nombre de travailleuses dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes et des sessions de formation du personnel sur le harcèlement.
Aux lacunes de la législation s’ajoutent la corruption, l’éloignement des zones rurales, l’analphabétisme, le manque de confiance dans les institutions publiques, la pression de la société, mais aussi l’absence de mesures et de services de protection pour les femmes qui osent dénoncer. Chaque année au Maroc, plus de 300.000 femmes sont victimes d’agressions et de harcèlement sexuels ou de rue. Un phénomène qui s’intensifie de plus en plus dans les voies publiques, devenant très grave, car ces agresseurs ne se cachent plus, allant même jusqu’à exposer leurs actes haïssables sur la toile. Des comportements indignes et inqualifiables qui ne cessent de s’intensifier, mettant à mal les victimes dans la vie de tous les jours.
En effet, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan (HCP), 372.000 femmes sont victimes, annuellement, de harcèlement sexuel dans les espaces publics, 32.000 femmes actives subissent des formes de violence sexuelle dans leur milieu de travail, avec un taux de 3,8% dans le secteur privé, et 15.000 étudiantes sont également victimes de harcèlement dans les établissements d’enseignement.
“Ces actes de harcèlement sexuel doivent impérativement être punis par la loi”, martèle Bouchra Abdou, militante féministe et présidente de l’Association Tahaddi pour l’Egalité et la Citoyenneté. La loi offre aux victimes la possibilité de poursuivre leurs agresseurs en justice, mais une réaction immédiate est cruciale. “La victime doit se diriger vers les services de sûreté les plus proches pour déposer une plainte et relater les faits”, insiste-t-elle. Des impacts profonds sur la santé physique et mentale des victimes. Loin d’être anodins, ces comportements harcelants laissent des traces indélébiles sur les victimes. “Le harcèlement, qu’il soit de rue ou physique, est considéré comme un acte criminel punissable par la loi”, rappelle la présidente de l’association. “Il compromet l’intégrité physique de la victime, impacte sa santé mentale et limite considérablement ses libertés dans les espaces publics”.
“D’un point de vue juridique, la présidente de l’Association Tahaddi pour l’Egalité et la Citoyenneté met en lumière la loi 103.13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes, mise en place pour protéger les femmes dans l’espace public, et notamment sur ses articles 503-1-1, qui prévoient « que toute personne qui a harcelé l’autre de manière persistante est considérée comme coupable de harcèlement sexuel, ce qui inclut le harcèlement «dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles ».
Trois profils de harceleurs: impuissance, perversion, et narcissisme
Pour Hatim Charafi Drissi, médecin psycho-sexologue, les motivations des harceleurs sont évidentes. Il identifie trois cas tout à fait distincts : “Il y a l’homme qui se sent impuissant car il ne dispose pas d’une force psychologique qui lui permet d’imposer son pouvoir et son statut social dans la société. Le second est le pervers, celui-ci prend un malin plaisir à rabaisser et à mépriser sa victime, et puis finalement il y a le narcissique, qui se considère supérieur à la gent féminine en général, manifestant un besoin excessif d’être admiré par ses victimes.”. Ces comportements engendrent une multitude de victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles.
Une objectification des femmes et une culture masculine sexiste à combattre
Dans ce sens, Bouchra Abdou dénonce une dangereuse tendance à la “chosification” des femmes. “La femme est aujourd’hui assimilée à un objet, réduite à un corps”, déplore-t-elle. “Les hommes laissent penser que leurs actes envers elles sont légitimes, que les insulter, les draguer ou les frapper est normal”. Cette culture masculine sexiste inculque des modes de pensée néfastes qu’il est urgent de déconstruire.
L’éducation sexuelle: un outil essentiel pour prévenir le harcèlement
Par ailleurs, face à ce fléau, le médecin psycho-sexologue insiste sur l’importance de l’éducation sexuelle, particulièrement au Maroc, contexte marqué par la religion musulmane et ses codes vestimentaires spécifiques. “L’éducation sexuelle informe sur la sexualité et transmet des valeurs et des recommandations”, explique-t-il. “Elle commence dès l’enfance et se poursuit tout au long de la vie”. Aborder les sentiments amoureux, les pratiques sexuelles, la santé sexuelle et reproductive, le consentement et le respect mutuel sont des éléments clés pour prévenir le harcèlement et construire une société plus respectueuse des droits des femmes.
Au-delà de la répression, les autorités marocaines ont également mis en place des mesures préventives visant à sensibiliser le public et à protéger les victimes. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été lancées pour informer le public sur les lois existantes et encourager les victimes à porter plainte. Les forces de l’ordre ont également été formées pour identifier et réagir aux incidents de harcèlement de rue.
Face à l’ampleur du phénomène, les femmes marocaines engagées ne se résignent plus. De nombreuses associations et collectifs féministes se mobilisent pour dénoncer ce fléau et promouvoir l’égalité des sexes. Ces organisations organisent des campagnes de sensibilisation, des ateliers d’éducation sexuelle et des actions de plaidoyer pour l’adoption de lois plus protectrices des droits des femmes.
La parole se libère mais reste prudente
De son côté, le collectif #masakatch, « Je ne me tais pas », est à la tête du féminisme 3.0, qui prône des méthodes nouvelles pour changer les consciences. Fondé dans l’espoir de reproduire au Maroc la campagne mondiale #Metoo, le hashtag est apparu le 18 septembre sur Twitter, le jour même du placement en détention provisoire en France de la star marocaine Saad Lamjarred.
Le collectif, qui réunit des femmes mais aussi quelques hommes, veut libérer la parole, convaincre les femmes de s’exprimer sur les réseaux sociaux, d’y raconter leurs histoires.
Dès son lancement, l’action de #Masaktach alimente le débat au point d’irriter les féministes « old school » qui attaquent le collectif, considérant qu’il ne s’agit pas d’un combat d’avant-garde. En clair, le pays a avant tout besoin de l’amélioration de son économie, de combattre la corruption, repenser l’éducation nationale et la généraliser, sortir les citoyens de la précarité de la pauvreté.
Par la suite, le mouvement #masaktach a lancé un hashtag #machi_b_sif (« pas sous la contrainte ») qui veut imposer le respect du consentement.
D’autres moyens font surface permettant aux femmes d’exprimer leur ras-le-bol. L’émancipation est sur les chapeaux de roues. Les langues commencent à se délier afin de s’extirper de la chape de plomb qui pèse sur leurs épaules. Dans une web-série ayant pour nom “Marokkiat” diffusée en 2018, des femmes marocaines brisent les tabous et les pressions sociétales. Homosexualité, harcèlement, interdits vestimentaires, aucun sujet n’est occulté. Douze vidéos rapides et incisives dans lesquelles douze femmes – une par épisode – filmées en pleine rue et à visage découvert, clouent au pilori les prétendues bienséances de la société marocaine.
Elles s’appellent Rihab, Selma, Fatma, sont étudiantes ou vendeuses, retraitées, voilées, tatouées, bisexuelles. Aucune ne se ressemble, et pourtant toutes ont quelque chose à raconter. Devant la caméra de Sonia Terrab, à Casablanca, ces femmes lambdas livrent un peu de leur histoire, au beau milieu de la rue, dans des pastilles de moins d’une minute. Le ton est cru, vif, spontané.
“J’avais envie de poster des femmes dans la rue, dans cette rue hostile et sauvage qui ne leur appartient pas, pour que le temps d’une prise de parole, elles disent je suis là, j’existe, qu’elles s’approprient cet espace”, explique Sonia Terrab, 33 ans, réalisatrice de la web-série. Le succès est phénoménal. En quelques mois, la série diffusée sur la page Facebook Jawjab a généré plus de 6 millions de vues.
« J’ai compris que je vivais dans une société où, que tu sois nue, habillée, en burqa ou même cachée sous un drap, l’homme te regardera toujours comme une chose », lance Khadija, 21 ans, dans l’un des épisodes des Marokkiat, racontant ce qu’elle vit depuis qu’elle porte le voile. « La fille doit suivre des normes et s’habiller selon le principe des hommes, pour qu’ils ne soient pas tentés : n’importe quoi !, s’insurge Nada dans une autre vidéo. En tant que filles, on est des demi-êtres et ça, ça me dérange. »
Récemment, le Collectif 490 a dévoilé son guide « le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire » A la tribune, Narjis Benazzou, biologiste et membre du collectif 490, Adam Elhadi, psychologue bénévole au sein de la cellule d’écoute du collectif 490 et Zainab Fainab Fasiki, illustratrice et activiste féministe, évoquant, tour à tour, la génèse de ce projet et son importance face à un tel fléau.
Ce guide se présente sous forme de BD dont les dessins sont signés Zainab Fasiki. C’est un outil destiné à sensibiliser, à prévenir et à lutter contre ce phénomène, en donnant notamment des conseils juridiques et des réponses pratiques aux étudiant(e)s victimes et/ou témoins. « Le silence autour du harcèlement sexuel s’explique par plusieurs raisons, indique le collectif 490. Les victimes craignent d’être stigmatisées et considérées comme responsables parce que “provocantes” par leur habillement ou leur attitude ». Et d’appuyer : « Les victimes ignorent leurs droits et ne savent pas à qui s’adresser pour se plaindre ou comment utiliser les procédures, elles doutent de l’efficacité de porter plainte, craignent les difficultés de preuves et les représailles. »
Le guide de lutte contre le harcèlement sexuel a été élaboré en partenariat avec l’association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMVEF) et avec le soutien du Fonds Canadien des Initiatives Locales (FCIL)
Un changement de mentalité nécessaire
En fin de compte, lutter contre les violences envers les femmes doit conduire à mener plus largement une politique pour lutter contre les stéréotypes de genre et ce dès l’école, lieu de formation à la vie en collectivité et à la citoyenneté. On le voit, les violences sexistes et sexuelles dans l’espace public s’inscrivent dans un espace circonscrit mais elles sont symptomatiques des rapports entre les femmes et les hommes et montrent combien ce phénomène est diffus dans la société, à travers une banalisation de ces violences sexistes et sexuelles qui contribue à une « culture du viol ».
Entre jeu de séduction et harcèlement, le comportement de la gent masculine est teinté de flou. Dans une société où les scandales à caractère sexuel jouissent d’une grande audience, nourrie sans doute par le porno sur Internet accessible à tout le monde, les hommes semblent souffrir d’une distorsion de la réalité au point de mélanger le monde pornographique et celui du réel.
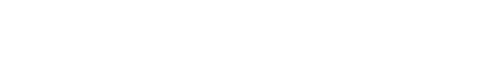

Laisser un commentaire